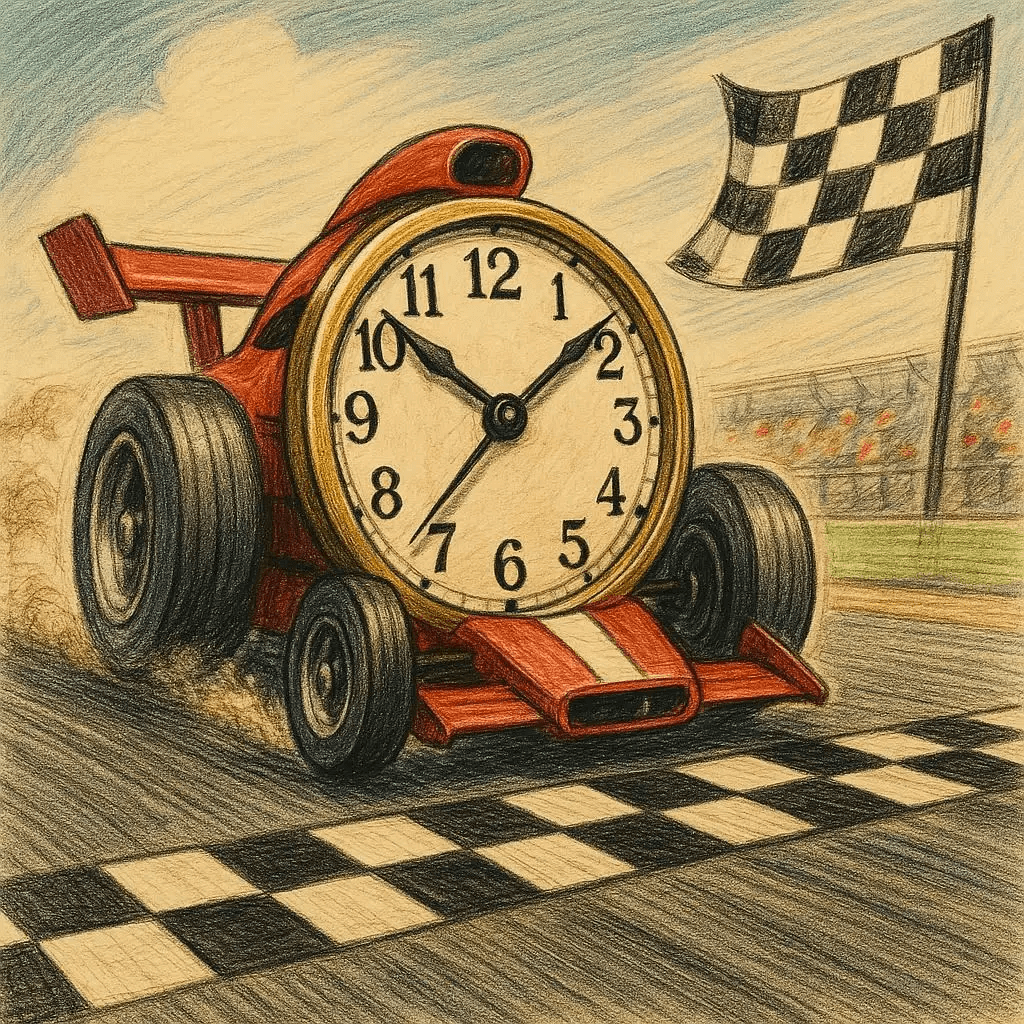Ce post va être un peu spécial (non, c’est pas sponsorisé par BiduleVPN) puisque je vais pas parler de Linux ou de cybersécurité mais de la notion du temps souvent évoquée par Étienne Klein dans de nombreuses conférences à ce sujet. Et un élément important à ses réflexions semble être absent.

Qui est Étienne Klein?
Pour les quelques-uns du fond qui ne connaissent pas ce grand homme, on pourrait résumer en disant qu’il est connu pour vulgariser la science et ses mystères. Il explique des principes complexes avec des mots simples, partage des extraits de vie de grands scientifiques, leurs recherches, leurs découvertes et aussi leurs erreurs. C’est un grand fan d’Albert Einstein et des Rolling Stones, qui comme il l’a démontré plusieurs fois ne sont pas incompatibles. Et parmi ses sujets de prédilections, même peut-être LE sujet, c’est le temps.
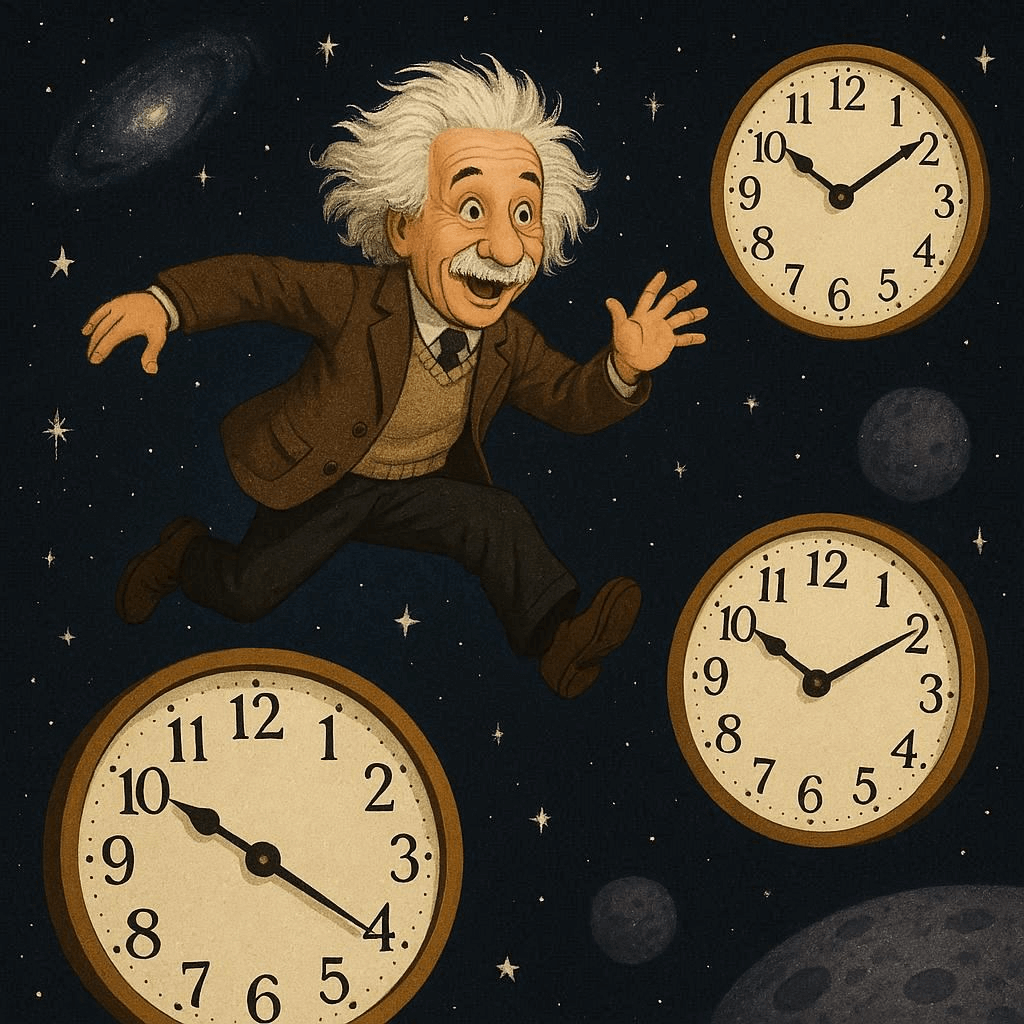
Qu’est-ce que le temps selon Étienne Klein?
Du point de vue scientifique, il considère le temps comme une grandeur mesurable et une dimension de l’univers, inséparable de l’espace dans la théorie de la relativité générale d’Einstein. Cela signifie que le temps n’est pas universel ou absolu : il peut s’écouler différemment selon la vitesse d’un objet ou la gravité à laquelle il est soumis. Par exemple, une horloge placée près d’un champ gravitationnel fort « tourne » plus lentement que celle exposée à un champ faible. Cette relativité du temps est une découverte majeure qui transforme la compréhension classique du temps linéaire et constant.
Philosophiquement, Etienne Klein aborde le temps comme une expérience subjective liée à la conscience humaine. Le temps perçu ne correspond pas forcément au temps physique, car notre cerveau organise notre expérience en séparant un passé irréversible, un présent immédiat et un futur incertain. Cette conscience d’un « cours du temps » qui avance toujours dans une seule direction s’oppose à la symétrie des lois physiques, où les équations fonctionnent aussi bien dans un sens que dans l’autre (passé vers futur ou futur vers passé).
Pour relever cette contradiction apparente, Klein introduit la notion de distinction entre le « cours du temps » (le temps mesuré par les instruments, caractérisé par une symétrie dans les lois physiques) et la « flèche du temps » (l’aspect irréversible, directionnel, marquant le devenir, vécu par la conscience). Cette flèche du temps est liée à des phénomènes comme l’entropie en thermodynamique, qui fait que l’ordre décroît toujours dans l’univers et impose un sens au temps.
Enfin, Etienne pointe que notre langage reflète souvent cette confusion entre temps physique et temps vécu, ce qui peut engendrer des incompréhensions tant en philosophie qu’en physique
Son obsession du temps qui ne peut pas s’écouler ni s’accélerer
Étienne Klein utilise avec un peu d’humour l’image de la voiture ou de la rivière pour illustrer l’écoulement du temps. Il précise que pour qu’une rivière coule, elle a besoin d’un lit (pas celui de votre chambre, juste au cas où). Un écoulement est quelque chose qui se déplace dans un cadre fixe, qui ne bouge pas, comme les berges à partir desquelles on peut apprécier le mouvement de l’eau. De la même manière, pour que le temps s’écoule, il faut un « support » qui ne s’écoule pas lui-même (un cadre immobile ou permanent dans lequel le temps peut s’écouler).
Comme, selon Étienne Klein, ce « lit » n’existe pas pour le temps, il en conclut donc que le temps ne s’écoule pas. Ou que « Il faudrait dire alors que le temps est quelque chose qui s’écoule de 24h toutes les 24h et on sera bien avancé avec ça ».
Il précise aussi que quand on regarde une rivière qui coule depuis la rive, c’est un peu comme quand on parle du temps qui passe. Cependant, il souligne la difficulté fondamentale : on ne peut pas se mettre « en dehors » du temps pour l’observer comme on regarderait la rivière depuis la berge, car nous sommes toujours dedans.
Etienne Klein met ainsi en garde contre l’idée que le temps aurait une « vitesse » ou qu’il s’écoulerait tout seul. L’écoulement du temps est un phénomène relié à notre position à l’intérieur de ce cadre immuable, ce qui évite la paradoxale notion d’un temps qui s’écoule dans un autre temps.
Selon Étienne Klein, si le temps n’a pas de vitesse, alors parler du temps qui s’accélère est un non-sens.
Petite réflexion à ce sujet
Le temps, du moins notre manière de la concevoir, est une notion créée par les humains. Les dinosaures ou les premiers mammifères (on ira pas jusqu’au plancton) n’avaient pas de montre ni d’horloge, ne se donnaient pas rendez-vous à 10h15 devant le grand chêne au bord du lac, n’avaient pas conscience des notions de semaines, mois, années. Tout ceci a été créé par nous, les humains, à force d’observer les mouvements du soleil dans le ciel, d’avoir conscience des répétitions des périodes chaudes et froides qu’on appelle maintenant « saisons », des différents formes de la lune qui reviennent toujours dans le même ordre. En se basant sur ces observations, nous avons alors créé des points de repères pour synchroniser des actions avec d’autres humains, pour le commerce comme pour se détendre.
On a fini par théoriser tout ceci, par créer des unités pour mesurer les durées relativement courtes, puisque se donner rendez-vous à l’apogée du soleil c’était pas toujours précis, surtout pour du commerce. Ces unités étaient définies par la lumière du soleil qui fait bouger une ombre en fonction de sa position dans le ciel. Ce système a fini par devenir quelque chose d’incontournable dans toute nation, moderne ou pas.
Pour les durées plus longues, on utilise tous un autre outil qui s’appelle le calendrier. Que ce soit en Europe comme en Chine, cet outil a aussi été créé par l’être humain il y a plusieurs millénaires. Et c’est sur ceci qu’on va s’attarder un peu plus.

En quoi le calendrier important dans ce contexte?
Qu’on soit dans un pays qui utilise le calendrier grégorien, hégirien, chinois, ou un autre, chacun commence par un début et fini par… une fin oui, bien vu! On va prendre le cas du calendrier grégorien qu’on utilise en Europe, qui contient 365 jours (366 pour les années bisextiles) divisés en 12 mois ou 52 semaines.
Chaque année commence toujours par un premier janvier, que l’année soit bisextile ou non. Elle se termine toujours par un 31 décembre qui est la St Sylvestre. On a donc quelque chose de fixe, parfois étendu d’une journée tous les 4 ans mais ça reste fixe, et fiable quand-même, puisque cette exception est caculée précisément. Le calendrier sera donc le lit de notre rivière.
Quand on dit qu’on a 10 ans, ça veut donc dire qu’on a fait 10 fois ce cycle qui va du 1er janvier au 31 décembre. Une année représente donc 1/10 de notre vie, ou 10% pour faire plus simple. Quand on a 20 ans, une année ne représente plus que 5% puisqu’on a vécu 20 fois ce cycle. Arrivé à 40 ans ça descend à 2.5%, et à 1.25% quand on a 80 ans, puis enfin 1% quand on a 100 ans. De fait, quand une personne qui a quelques décennies au compteur dit que « cette année est passée trop vite » ou que « Le temps passe de plus en plus vite », ça vient de ça.
On voit que ce pourcentage réduit au fil de notre vie. Plus on vieilli, plus la durée de ce calendrier devient insignifiant. Quand on a vécu 100 fois ce même cycle, un de plus ou un de moins ne fait plus de réelle différence, alors que quand on a 5 ans et qu’une année représente 20% de notre vie, une année semble très longue (souvenez-vous quand vous attendiez le Père Noël qui n’arrivait jamais).
Conclusion
Comme le dit Étienne Klein, pour que le temps s’accélère, il faudrait qu’il ait une vitesse. Le temps ne peut s’écouler que si il se déplace dans quelque chose d’immobile. Cette chose, c’est donc bien le calendrier qu’on utilise tous. C’est par rapport à lui que le temps propre de chaque personne s’écoule et s’accélère. C’est sur lui que notre vie avance, tel un pion sur un jeux de plateau. Plus le temps « passe », plus un tour de plateau représente une partie infime de la partie. Ce qui en fait donc une notion subjective mais pourtant bien ressentie par des milliards de personnes à travers le monde, au fil des années, qui leur paraissent toujours plus courtes.
Mais comme disait Sénèque, « Notre vie est assez longue, si nous savons bien l’employer ». Un truc comme ça…